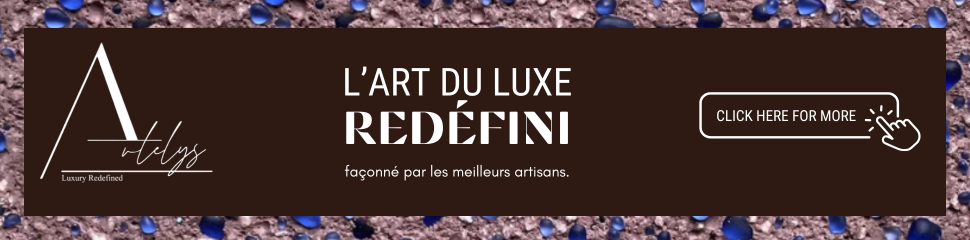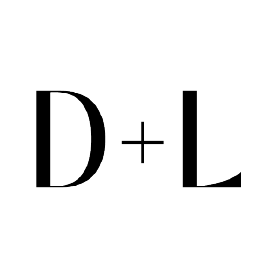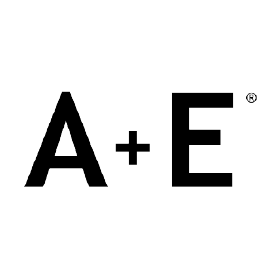Restauration du patrimoine : Le façadisme, une peau de chagrin ?

La thèse doctorale soutenue le 08 novembre 2021, par Karima Berdouz, questionne le façadisme comme pratique architecturale qui s’est établie en Europe durant les années 1970-1980 et au Maroc au début des années 2000, comme un procédé de rétention de façades historiques, des parois extérieures des bâtiments anciens, ou comme la création de répliques de ces façades avec des édifications nouvelles ayant un caractère contemporain à leurs intérieurs.
La façade, l’une des composantes majeures d’un édifice, joue un rôle d’interface avec le monde extérieur en véhiculant plusieurs messages, qu’ils soient implicites, explicites ou symboliques, offrant ainsi un continuum linéaire de la rue. L’attachement populaire à cet héritage urbain rend le patrimoine difficile à démolir et résiste tant bien que mal à ce désir de réexploiter son rare foncier.
Le fondement théorique est une tentative de préservation de l’image historique, en sauvegardant systématiquement les façades de bâtiments datant du XXe siècle, justifiant d’une valeur patrimoniale et situées généralement dans des espaces urbains de qualité.
Considéré alors, comme un élément de discrédit, le façadisme est souvent évoqué de manière inconsidérée dans le cadre de la conception architecturale et urbaine actuelle. L’objectif avancé de cette pratique est d’augmenter la densitée urbaine tout en respectant la conservation patrimoniale bâtie.
De même, il est essentiel de soulever que l’usage du façadisme résulte aussi d’un compromis de facteurs inhérents à la sauvegarde du patrimoine : spéculation immobilière, force du marché, densification urbaine, législation, normes et compétences des praticiens. Il est alors considéré par quelques experts comme la garantie d’une sauvegarde « faciale » du paysage urbain. Il nuit même aux efforts consentis pendant plusieurs années au principe d’une architecture innovante et créative qui engendre néanmoins la perte irréversible, notamment, d’informations historiques.
Cette pratique architecturale, et urbanistique nouvelle, qui commence à se propager à Rabat et à Casablanca, et sur laquelle les travaux de recherches sont encore inexistants au Maroc, a encouragé l’architecte Karima Berdouz à s’engager dans cette voie d’investigation. Son travail est une première contribution en la matière.
Le devenir de la recherche dans ce domaine est encore large et ouvert, car le travail sur le terrain n’est toujours pas suivi, parallèlement ou à postériori, d’une production analytique scientifique.
De manière assez sournoise, dans les médinas marocaines où nous ne sommes plus, uniquement sur le monument ou le bâtiment, mais sur des grandes façades urbaines, cette-ci deviennent un décor de pacotille par rapport à l’évidage que subissent les demeures à l’intérieur. Le cas de Marrakech ou de Fès actuellement est assez parlant.
Ce « tâtonnement expérimental », provoque ainsi, un paysage urbain, conçu par les pressions économiques, loin de toute réflexion intellectuelle prospective.

Figure 1 : Immeuble le Gourmet, place Al Joulane, Rabat avant travaux de façadisme, photo Internet
Figure 2 : Immeuble le Gourmet abritant l’agence du Bouregreg. place Al Joulane, Rabat photo Karima Berdouz 2021
Figure 3 : image illustrant une photographie de la façade de l’immeuble de la Société Générale en 1925, source : musée photographique de la Société Générale Casablanca.
Figure 4 : Image illustrant l’immeuble de la société Générale à Casablanca, actuellement, Photo Karima Berdouz 2018.
Figure 5 : Immeuble Société Générale, avenue Med V Casablanca, Photo SOGEA 2013
INTERVIEW – KARIMA BERDOUZ

- Vous avez passé une thèse de doctorat en architecture sur un sujet patrimonial. Pourquoi ce choix ?
Karima BERDOUZ : « Tout d’abord je tiens à rendre hommage à l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat, qui, grâce à ses enseignants hautement qualifiés et son staff administratif, m’a fait bénéficier d’un très bon encadrement scientifique et humain m’incitant à continuer mon chemin dans la recherche.
Concernant la problématique du « façadisme comme pratique architecturale et patrimoniale » traitée au niveau de ma thèse de doctorat, elle touche principalement le patrimoine architectural du XXe siècle, appelé aussi « patrimoine récent » : des immeubles « vivants ou en fin de vie » existants et hérités qui composent l’image de nos villes.
Les transformations que connait ce patrimoine « vivant » ces dernières décennies, m’ont poussées à réfléchir sur une nouvelle pratique « architecturale » qui gagne de plus en plus de terrain dans nos villes, celle de transformer des immeubles en sauvegardant leurs façades et démolir les dalles afin d’y incorporer une nouvelle construction.
La réflexion sur cette problématique, a été nourrie de mon expérience antérieure dans la pratique du métier d’architecte durant 15 ans dans un département ministériel marocain. J’étais confrontée à réfléchir, aux côtés de la maîtrise d’œuvre, à des solutions pour faire revivre quelques bâtiments d’une grande valeur architecturale et patrimoniale et leur redonner une nouvelle vie. Je peux citer la « villa d’hôtes » de Lyautey à Rabat, un vrai chantier « cas d’école » de réaménagement et de réhabilitation, où le maître d’œuvre n’a transformé ni les aspects intérieurs-extérieurs ni la fonction du bâtiment ; il a même sauvegardé des éléments architectoniques d’une grande valeur patrimoniale, comme les escaliers, les cheminées et le parquet au sol. Seules les dalles ont été refaites à neuf.
Ce chantier, avec celui de l’immeuble le Gourmet, (plus connu sous le nom immeuble de l’agence d’aménagement de Bouregreg – figure 1 et 2) m’ont marqué pendant plusieurs années. C’est pourquoi, quand le Centre des études doctorales a vu le jour pour la première fois à l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat, en 2015, j’y ai vu une opportunité afin d’assouvir ma soif de connaissances dans la recherche en préparant une thèse en architecture. »

- Pourquoi un doctorat en architecture et non pas en archéologie, par exemple, comme il est de coutume pour les recherches sur le patrimoine ?
K.B « Vitruve nous a rapporté que : « L’architecture est une discipline constituée de plusieurs enseignements et de divers savoirs permettant de porter un jugement sur tous les ouvrages accomplis par les autres métiers. »
C’est pourquoi, mon choix s’est porté d’une manière « spontanée et naturelle » sur une thèse en architecture pour traiter une problématique touchant à la fois le patrimoine du XXe siècle et l’architecture. Aussi le maillage transdisciplinaire de la recherche doctorale en architecture, sans mention complémentaire « urbanisme » ou « patrimoine » renvoie à la particularité pluridisciplinaire des écoles d’architecture, particulièrement au Maroc. »
- Dans beaucoup de pays, comme en Belgique dans les années 70 et 80, la bruxellisation s’est imposée comme un ultime recours. Sans législation marocaine spécifique, ne pensez-vous pas que le façadisme va permettre à de nombreux promoteurs immobiliers de venir à bout des faibles résistances des défenseurs du patrimoine à moindre cout ?
K.B « En matière de façadisme, le Maroc n’a toujours pas tranché sur cette pratique, mais reste sur des recommandations sommaires sans indications claires sur la démolition ou pas d’un bien historique. Aussi, si nous effectuons une lecture des types d’intervention sur le bâti historique menaçant ruine, nous pouvons lire la préconisation de démolir une partie du bâtiment menaçant ruine et la reconstruction nouvelle des parties endommagées.
De plus, les changements d’usage cachés par le façadisme peuvent avoir un impact sur le tissu social. Le recours au façadisme permettrait même de transformer des alignements résidentiels patrimoniaux, généralement constitués de surfaces restreintes, en bureaux ou en équipements culturels de plus grandes surfaces destinés à une classe touristique ou aisée.
Par conséquent, la pression des promoteurs et l’enjeu spéculatif d’une économie ouverte peuvent fournir un nouveau produit dans la gestion chaotique de la ville, avec le motif d’être sous un « vieux » visage, en ciblant le centre-ville urbain.
Le façadisme est devenu ainsi le représentant de la Culture consumériste dans l’architecture contemporaine.
Ce débat entre conservation et nouvelles interventions, sur les anciens tissus, est devenu davantage un débat philosophique. »
- Pour le moment l’ensemble des projets de façadisme concernent Casablanca et Rabat. Pensez-vous que les autres villes vont être contaminées à leur tour ?
K.B : « Les villes marocaines regorgent d’un patrimoine architectural très riche, elles proposent un potentiel précieux pour un développement économique et social durable. La protection de leur patrimoine architectural est une mission qui dure dans le temps et qui nécessite une approche globale si la conservation des villes historiques est une finalité en soi. Ce qui fait que la conservation des centres historiques est une composante d’un processus plus large englobant tous les aspects de la vie urbaine.
Le façadisme a fait l’objet de discussions depuis plusieurs décennies en Europe et en Amérique et apparait généralement comme une mauvaise pratique dans le domaine de la conservation du patrimoine bâti. En Europe comme en Amérique, la polémique entre les partisans d’une préservation intégrale des bâtiments patrimoniaux et celles et ceux qui voient dans la récupération d’une façade une solution de compromis acceptable ressurgit à chaque nouveau projet de façadisme. Au Maroc, la réflexion n’a pas encore trouvé un collectif parmi les défenseurs du patrimoine bâti marocain. Aussi, il est devenu une solution rapide, dans une société qui impose le neuf à toute vitesse, et semble trouver ancrage dans des solutions de facilité et de réconfort en matière de conservation. (Figure 3, 4,5).
D’autres villes voient déjà dans le façadisme une solution discrète pour une intervention radicale sur leur patrimoine architectural bâti, je donne l’exemple du Cervantes à Tétouan où on a déjà procédé, il y a quelques années de cela, à une reconstruction totale de ses planchers tout en sauvegardant ses façades,
C’est vrai que ce phénomène reste rare dans d’autres villes marocaines, mais avec la transmission du savoir, probablement, d’autres acteurs locaux suivront les expériences antérieures et à adopteront cette pratique comme solution « ultime » et « rapide » à un renouvellement urbain.
Faudrait-il souligner que Casablanca et Rabat sont riches en patrimoine « récent » plus que les autres villes. Ce qui est par ailleurs fréquent dans ces villes est le façadisme passé sous silence dans les médinas, notamment Marrakech et Fès. Serait-ce ainsi parce que l’architecture médinale est par essence introvertie contrairement à celle du XXe siècle ? »
- Vous l’avez dit dans votre thèse, ICOMOS se positionne contre le façadisme. Cette pratique sans garde-fous peut-elle nuire à l’image du Maroc sur le long terme ?
K.B : « Le façadisme n’est pas une doctrine, c’est une pratique fondée sur des projets.
L’association culturelle ICOMOS est particulièrement présente au Maroc, en particulier à Rabat, pour œuvrer à la préservation de l’héritage colonial urbain et a déjà mis en œuvre différentes initiatives de sensibilisation du public (expositions, itinéraires de promenades, tables rondes et articles de presse);
De même plusieurs opérations de protection et de réhabilitation de bâtiments emblématiques ont été engagées dans la ville de Rabat, en présence d’ICOMOS, lors des commissions d’autorisation de surélévation des immeubles faisant l’objet de façadisme.
La position d’ICOMOS est sans équivoque face au façadisme : il n’y a pas de place pour cette pratique dans une stratégie de conservation (sauf en cas de force majeure). Il s’agit ici d’une prise de position on ne peut plus claire et catégorique.
Le principe d’ICOMOS dans la réflexion patrimoniale, réside dans la réparation ou la restauration des biens immobiliers à valeur historique, plutôt que la reconstruction. La stabilisation, la consolidation et la conservation des éléments significatifs sont préférables au remplacement. Dans la mesure du possible, les matériaux de remplacement doivent être identiques, mais marqués ou datés pour les distinguer.
De même, l’UNESCO vient consolider l’avis de l’ICOMOS, en adoptant un document exposant le mémorandum de Vienne (2005) sur les lignes directrices pour l’intégration de l’architecture contemporaine dans le paysage urbain historique. Les bonnes pratiques n’incluent pas le façadisme. L’urbanisme, l’architecture contemporaine et la protection des paysages urbains historiques doivent éviter toute forme de conception pseudo-historique, car elles constituent un rejet des aspects historiques et contemporains.
La protection des biens immobiliers est souvent perçue comme un blocage au développement (socio-économique) des villes, ce conflit introduit le défi auquel sont confrontées les villes du patrimoine mondial, essayant de continuer à se développer de manière durable sans porter atteinte à ses valeurs culturelles.
Les villes marocaines, à l’instar des villes patrimoniales mondiales, s’engagent dans le processus de préservation du patrimoine architectural bâti, et quelle que soit la solution adoptée, cela ne peut nuire à leur image. Le choix de la méthode est toujours une question de jugement subjectif et d’appréciation. »
- Vous parlez également de Ibn Khaldoun et ses doctrines sur le patrimoine. Quels sont ses enseignements à ce propos ?
K.B : « Ibn Khaldoun nous a expliqué dans son célèbre manuscrit « كتاب العبر » (Kitab al-Ibar) qui constitue l’œuvre principale et pionnière en histoire universelle, comment devrait être la relation avec l’histoire : « l’histoire a un autre sens. Elle consiste à méditer, à s’efforcer d’accéder à la vérité, à expliquer avec finesse les causes et les origines des faits, à connaître à fond le pourquoi et le comment des évènements ».
Dans les Cultures arabe et islamique, le patrimoine matériel n’est pas pertinent s’il est séparé de l’usage quotidien. C’est ce qu’utilise Ibn Khaldoun pour expliquer la relation « destructrice » entre les Bédouins et les sites patrimoniaux pour leur survie, seule la réutilisation de la pierre et du bois dans les activités de la vie quotidienne peut fonctionner.
Il a également souligné que chaque nouvelle dynastie exprimait une attitude négative envers les traces matérielles de la dynastie précédente, en essayant de les détruire ou au moins de les abandonner, ce qui est contraire à la continuité espérée dans la philosophie de la conservation du patrimoine.
Pour Ibn Khaldoun, tout intérêt à un patrimoine bâti doit être lié à son usage, tout legs doit être réutilisé, voir même transformé pour justifier sa présence. Le manque d’intérêt pour les objets construits, non utilisés est dû au culte des « livres » au détriment des « pierres ». L’absence d’une définition claire du terme patrimoine reste problématique, car elle limite largement le sens logique de tout développement patrimonial et affecte ses effets. »
- La sensibilisation au patrimoine est un processus au long cours. Où, selon vous, en sommes-nous au Maroc et quel bilan faites-vous des actions engagées à ce jour ?
K.B : « Le développement du secteur immobilier au Maroc et l’engouement pour le patrimoine local survenu avec l’arrivée des européens voulant s’installer dans des Riads à bas prix ont fini par donner à ces centres historiques un coup de pouce au niveau de leur restauration et de leur réhabilitation. Des opérations quelquefois réussies et qui malheureusement, souvent, dénaturent le patrimoine voire le caricaturisent. C’est alors qu’un ensemble de voix se sont élevées pour protéger et sauvegarder les médinas. L’Agence pour la Dédensification et la Réhabilitation de la Médina de Fès (ADER-FES) est créée en 1989, une sorte « d’instrument pour la conservation de la médina de Fès » défendu par son initiateur feu El Hajjami, architecte-enseignant à l’ENAR et premier directeur de l’Ader.
L’administration marocaine n’avait jamais créé une structure pareille et c’était une initiative audacieuse pour son temps, vu qu’il n’y avait pas de véritable visibilité et retour d’expériences, notamment par rapport à son évolution et à son financement ; il s’agissait d’une structure publique unique au Maroc, dédiée à la réhabilitation des tissus historiques.
L’ADER-Fès a ouvert le chemin de la conservation du patrimoine à plusieurs autres organismes au Maroc, notamment à Casablanca, avec la société de développement local Casablanca Patrimoine, créée en 2015 à l’initiative des collectivités locales et à Rabat, avec la fondation pour la sauvegarde du patrimoine Culturel de Rabat, créée en 2020, présidée par la Princesse Royale Lalla Hasnaa.
Les villes nouvelles créées aux côtés des médinas, longtemps ignorées, parfois détruites, deviennent un laboratoire de transformations, fonctionnelles et revendiquées comme faisant partie du patrimoine national. L’exemple en est celui de la ville nouvelle de Rabat, actuellement inscrite à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Paradoxalement, ce classement se voit confronté à une législation urbanistique vieillissante : un plan d’aménagement datant de 1999 qui donne droit à un changement fonctionnel et architectural et dont les prérogatives essentielles sont les constructions nouvelles.
De plus, depuis les années 2000, plusieurs plans de sauvegarde ont été lancés. Sans assise juridique, ils ne sont pas opposables aux tiers, et ne sont pas, par conséquent, exécutables sur le terrain.
Il est important de souligner que, récemment, la société civile a pris un rôle important dans ce mouvement de défense du patrimoine architectural du XXe siècle. L’exemple de Casamémoire, une association marocaine à but non lucratif de sauvegarde du patrimoine architectural du XXème siècle au Maroc, a vue le jour en 1995 suite à la démolition de la « villa El Mokri » à Casablanca conçue par l’architecte Marius Boyer. Elle réunit un ensemble d’intellectuels : architectes, enseignants, journalistes et sera suivie plus tard en 1994, par la création de l’association Rabat-Salé mémoire.
Aussi, est-il important de constater, aujourd’hui, le rôle des réseaux sociaux à vulgariser la compréhension du patrimoine ; je donne l’exemple de la polémique qu’a suscitée le réaménagement du Café Maure aux Oudayas, ainsi que la gare Rabat-ville (figure 6).
Cette vulgarisation du patrimoine a fait naître une conscience patrimoniale populaire pour défendre un héritage patrimonial bâti ainsi qu’une mémoire collective.
Malgré cette panoplie d’intervenants dans le patrimoine, l’absence d’une « volonté audacieuse » des acteurs locaux dans la prise de décision, pour mettre en place un référentiel sur la conservation du patrimoine architectural bâti, les lourdeurs administratives, le manque de consensus sur les priorités, le manque de moyens dans certains cas, sont autant d’entraves potentielles à la conduite d’un programme de conservation du patrimoine bâti du XXe siècle.
Cette situation nous met en difficulté pour dire que la question du patrimoine a trouvé sa voie au Maroc. »
- Mais vous, quel point de vue portez-vous sur le recours au façadisme ?
K.B : « Bien que l’on ne puisse conclure que la notion de façadisme constitue un moteur privilégié d’une approche urbanistique liée à la conservation patrimoniale, elle reste liée à la préservation du patrimoine architectural bâti et urbain.
S’il est important de s’appuyer sur le savoir pour assurer la préservation et la protection du patrimoine architectural, j’ai constaté que les interventions patrimoniales ne se sont pas appuyées sur des méthodes de montée en connaissance en amont du projet.
Par conséquent, les projets de requalification patrimoniale réussis sont généralement le résultat d’études de caractérisation antérieures. Lorsqu’il est impossible de protéger complètement un bâtiment, de telles recherches peuvent prouver pourquoi certains éléments peuvent être exclus alors que d’autres doivent être absolument conservés. L’environnement du bâtiment ancien peut être adapté aux besoins contemporains de manière exceptionnelle et créative, tout en préservant la valeur patrimoniale. »
A propos du Centre des Etudes Doctorales de l’ENA
Les thèses préparées au Centre des Etudes Doctorales « Architecture et disciplines associée » de l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat et s’inscrivent dans les axes de recherche suivants :
- Histoire, théorie et critique de l’architecture.
- Fondements épistémologiques et méthodologiques de la conception en architecture.
- Composition et/ou modélisation du projet architectural et urbain.
- Soutenabilité en architecture et urbanisme
C’est le premier doctorat du genre au Maroc et un champ de recherche relativement récent à travers le monde.
La singularité du doctorat est intrinsèque à la recherche même en architecture. C’est une discipline en cours de construction et d’expérimentation de parcours méthodologiques et d’objets de recherches. En effet, l’objet de la recherche en architecture est toujours sujet de débat entre la recherche « POUR l’architecture » (architecture comme objet-terrain de recherche) plus proche du milieu scientifique ou la recherche « EN architecture » (dans l’objet-projet), qui est plus fréquente dans les agences d’architecture. Certains contestent tout court que l’architecture puisse faire l’objet de recherches. La question se pose aussi au niveau des méthodes et des outils de recherche ainsi que du cadre théorique. Pour le moment, puisant dans la transdisciplinarité, la recherche en architecture puise des outils et méthodes galvaudés des sciences humaines.
Le champ de recherche est également quasiment vierge, de l’architecture prédynastique, dynastique à l’architecture contemporaine, tout reste à étudier de manière fine et profonde dans une perspective de production de savoir.
Karima BERDOUZ
Architecte diplômée de l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat (2001)
Master en Management de la Maintenance, Ecole Mohammedia des Ingénieurs (2009).
Diplôme d’Etudes Supérieurs en Aménagement et Urbanisme, Institut National d’Aménagement et Urbanisme (2014).
Docteur en Architecture, Ecole Nationale d’Architecture Rabat, (2021).
Enseignante à l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat.