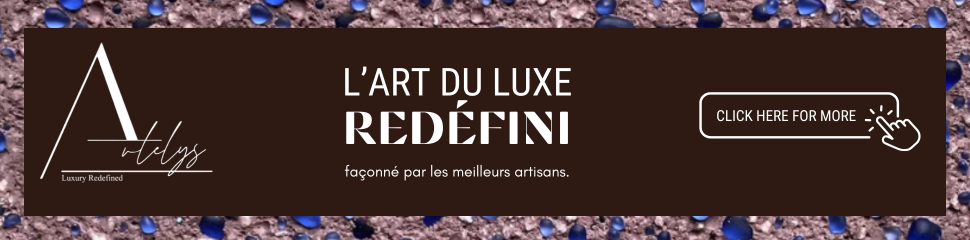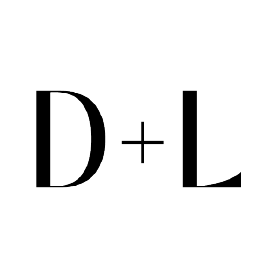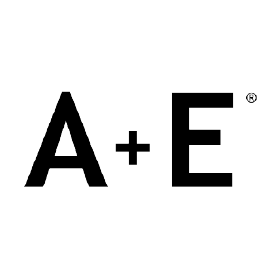L’architecture marocaine est morte et des architectes sont emprisonnés

La loi 66/12, une loi applicable sur le champ en faisant référence à des textes fantômes
Les articles 65/66 et 67 prévoient des contrôles inopinés par des agents de la police judiciaire et par les autorités des wilayas et des préfectures.
Ainsi la loi est entrée en vigueur sans fixer les modalités de son application et sans fixer les responsabilités de ces agents verbalisateurs, ce qui risque d’avoir pour conséquences des abus de pouvoir et des interprétations subjectives de la traduction des infractions, et ce, sans autre forme de recours.
Le contrevenant n’a donc pas le droit de contester l’infraction et la sanction, ni de demander un recours à qui de droit. Et s’il n’obtempère pas, il y aura saisie de ses biens matériels dans le chantier avec rapport au procureur du Roi.
A ces agents peuvent s’adjoindre, des contrôleurs en charge de l’urbanisme pour les observations de la conformité des plans autorisés dont les modalités de vérifications et les responsabilités restent aussi à définir dans les futurs textes.
En constatant l’infraction, la brigade transmet alors le procès-verbal au parquet dans un délai de 3 jours tout en décidant l’arrêt immédiat des travaux.
Le contrevenant dispose alors de 10 jours à un mois, en fonction des cas, pour se mettre en règle et si le délai n’est pas respecté, l’autorité ordonnera la démolition et le contrevenant sera sanctionné par des amendes ou des peines de prison allant jusqu’à 5 ans en cas de récidive.
La démolition concernera-t-elle l’ensemble de l’ouvrage ou seulement la porte incriminée ?
L’ensemble des infractions est basé sur la perception monolithique de l’ouvrage, figé par les plans autorisés liés aux règles urbaines sans cadrage technique au stage de l’avant-projet sommaire.
L’évolution du projet en fonction de ses phases de réalisation est un crime ordinaire sanctionné alors par les autorités compétentes.
Le texte prévoit, aussi, la même peine pour tous les acteurs de l’acte de bâtir de ce chantier s’ils ne dénoncent pas l’infraction dans un délai de 48 heures ainsi qu’aux complicités extérieures.
Comment imaginer alors l’ambiance entre les intervenants dans le chantier après l’arrêt et la délation du contrevenant ?
Un arrêt de chantier, même limité dans le temps, déstabilise l’entrepreneur.
Les ouvriers seront déployés sur un autre chantier ou mis au chômage technique, en attendant la reprise qui s’annonce difficile et après la réception favorable du permis modificatif qui peut durer de 3 à 6 mois.
Par ailleurs, les professionnels s’impatientent de voir venir le code de la construction du Ministère de l’habitat, un documents fantôme dont il est fait référence dans le texte de loi 66/12 pour définir les responsabilités de tout un chacun.
La loi 66/12 ou l’élan de solidarité improbable entre l’ensemble des acteurs de l’acte de bâtir
Cette loi a déclenché une solidarité, jusque-là improbable, entre l’ensemble des acteurs de l’acte de bâtir qui jusqu’ici, étaient préoccupés par travailler chacun dans leur coin, sans se soucier des imbrications des responsabilités juridiques des uns et des autres.
De même, les consciences et les solidarités entre architectes, qui étaient oubliées jusqu’alors se sont réveillées dans un élan rapide et dans un mouvement sans précédent à travers tout le Royaume, accéléré par la vitesse de communication des réseaux sociaux.
Ce mouvement a pris de l’ampleur à la conférence de presse des acteurs de l’acte de bâtir, le 25 novembre 2016, lors du Salon International du Bâtiment à Casablanca.
Ces acteurs se sont exprimés et ont démoli point par point les articles qui font références aux infractions passibles du pénal n° :
65-66 et 67 de la loi 66/12.
Ainsi, les architectes demandent que tous les acteurs de l’acte de bâtir soient obligatoirement associés au projet, de l’amont à l’aval, et ce quelle que soit la nature du bâti, de la villa à l’immeuble haut standing en passant par la maison marocaine et le logement social.
Ils plaident pour :
– Que toute construction se fasse dans les règles de l’art et soit inscrite obligatoirement dans un document d’urbanisme.
– Que tout intervenant dans l’acte de bâtir :
• appartienne à un organisme reconnu par les autorités qui l’agrée,
• soit à jour de ses cotisations,
• et respecte toutes les réglementations en vigueur.
– Que les responsabilités des uns et des autres soient reconnues dans le code de la construction et qu’il n’y ait plus de différence entre le bâtiment pour le public et le bâtiment pour le privé.
– Que les architectes et l’ensemble des acteurs de l’acte de bâtir aient un contrat unifiant le public et le privé avec les mêmes droits et les mêmes devoirs pour une et une seule architecture marocaine sur l’ensemble du territoire marocain.

Ceci déclenchera :
• la fin du clandestin et du non réglementaire,
• la fin des signatures de complaisances des riches et des pauvres,
• la fin de la dilution des responsabilités,
• la fin de la clochardisation des architectes et de leur mise en indexe comme des criminels de l’acte de bâtir,
• la fin des passe-droits des établissements publics et privés pour le gré à gré ; il n’y aura donc qu’un et un seul modèle de contrat de passation des marchés pour le public et pour le privé.
Ceci libérera la créativité des architectes et renouera avec le génie architectural de nos ancêtres qui nous ont laissé des chefs d’œuvres de beauté et d’esthétique inestimables.
Ainsi, les architectes devront saisir l’occasion de révision de la loi 66/12 pour régler tous les problèmes qui handicapent et gangrènent leur métier en matière :
1. de répartition de la commande publique et privée ainsi que son passage et sa gestion par des organismes externes rattachés aux conseils régionaux et supervisés par les autorités,
2. de mise en place d’un jugement ferme et transparent des concours et des consultations ainsi que l’amendement du décret de passation du marché public et de son application aux marchés privés,
3. de réduction des lenteurs et de la paperasse interminable des autorisations à construire,
4. de suppression de la subjectivité et des abus dans l’interprétation des jugements des règles de sécurité contre les risques d’incendie,
5. de fin de la rigidité des plans d’aménagement et de leur intégration dans les actions de la COP22,
6. d’harmonisation et de simplification de l’ensemble des règles et lois qui régissent l’acte de bâtir,
7. de suppression des voies d’élections des conseils par correspondance et de la mise en place du conseiller juridique,
8. la répartition des conseils régionaux en fonction de la régionalisation, il faut avoir un seul conseil par région pour être l’outil architectural au cœur du dispositif du développement régional,
9. de lutte contre les signataires de complaisance des projets pauvres et des projets riches, ainsi que de lutte contre les pratiques frauduleuses et les concurrences déloyales,
10. de mise en place de la caisse de mutualité sociale et de la maison de l’architecte par région,
11. de l’assurance d’un revenu annuel minimum par architectes d’au moins 200 000 HT, soit l’équivalent d’une réalisation de deux villas ou d’un immeuble R+5,
12. de mise en place de l’assistance architecturale à tous les citoyens ne disposant pas de moyens pour régler les honoraires des architectes et des bureaux d’études, payée par la Région ou par une autre collectivité locale,
13. d’obligation de formation continue aux architectes, payable par des organismes dédiés,
14. de mise en place d’ateliers régionaux d’architectes pour anticiper les problèmes des villes marocaines, payables par une caisse dédiée de développement régional,
15. de retour aux barèmes des honoraires HT issus de la loi de 47 :
7% pour un montant de travaux TTC de 0 à 100 0000 dhs
6% pour un montant de travaux TTC de 100 000 à 200 000 dhs
5% pour un montant de travaux TTC au-delà de 200 000 dhs
Et de leur actualisation en fonction de l’inflation de 1960 à 2017, ce qui donnerait : un taux d’inflation moyen de 4.36% sur 58 ans.
(Source statistique du commissariat au plan et de la banque mondiale : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/MAR/en/FP.CPI.TOTL.ZG.html.
Soit des taux de :
7 % de 0 à 25 000 000 dhs TTC du coût des travaux
6% de 25 000 000 dhs à 50 000 000 dhs TTC du coût des travaux
5% au-delà de 50 000 000 dhs TTC de coût des travaux
Rachid haouch
architecte,
urbaniste et paysagiste
Paru dans CDM Chantiers du Maroc n°146 – Janvier 2017
Pour réagir à cet article, envoyez-nous vos commentaires à communication@archimedia.ma