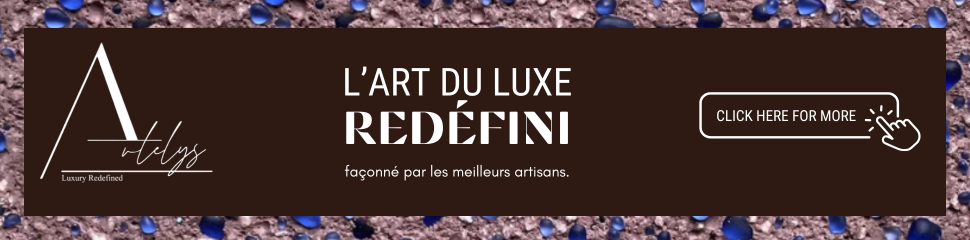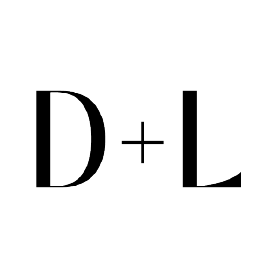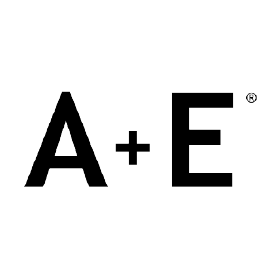L’architecture marocaine est morte et des architectes sont emprisonnés

La loi 66/12, de la lutte contre l’habitat non réglementaire à l’emprisonnement des architectes
Face à ce fléau de l’habitat non réglementaire et aux drames successifs, le Ministère de l’urbanisme a légiféré, sous le coup de la précipitation, par la loi 66/12 dont l’objet est le contrôle des irrégularités dans le domaine de l’urbanisme et de la construction en instaurant le contrôle et à la répression des infractions.
Ce faisant, la loi 66/12 a mis les œufs dans le même panier en confondant habitat clandestin et habitat réglementaire, en légiférant contre le clandestin tout en remettant en question le réglementaire : une belle contradiction qui ne passe pas inaperçue.
En effet, cette loi, qui se veut un référentiel unique pour l’organisation des chantiers de construction dans tout le pays afin d’éviter les facteurs qui ont causé les effondrements d’immeubles en cours de construction ne s’est pas focalisée sur les vrais problèmes qui sont à l’origine de ces drames. Elle a, tout simplement, désignée l’architecte comme le principal responsable.
Or, le métier de l’architecture est régi par la loi 16/89 qui instaure l’ordre national des architectes et son conseiller juridique qui est le seul garant pour faire respecter la loi par les architectes via des conseils de discipline.
Ce conseiller juridique tarde à être nommé par le Secrétariat Général du gouvernement pour procéder à de réelles sanctions et aux radiations des récalcitrants.
L’article 74 de la loi 16/89 dans son chapitre V relatif à la discipline prévoit le retrait définitif de l’autorisation d’exercer à un architecte incriminé par l’administration.
Et dans l’article 81 de la même loi et du même chapitre, il est stipulé que seul le Conseil National a qualité pour transmette au parquet sa demande de l’action disciplinaire.
Il y aura donc une double peine pour les architectes, d’une part, des fermetures de chantiers avec des amendes et des privations de liberté et d’autre part des risques de radiation du tableau de l’ordre.
Alors même que le Conseil National est assermenté par la loi pour appliquer ses propres disciplines pour les architectes défaillants, sans recourir aux autorités.
La loi 66/12 et le risque de blocage d’un important pan économique du pays
Le Maroc est un pays en construction et les acteurs du bâtiment représentent plus de 37 milliards de dirhams de chiffre d’affaires, 12 millions de tonnes de ciment consommées par an, 60000 entreprises dans le secteur du bâtiment, 52000 emplois créés en moyenne par an, 1,5 millions d’emplois dans le secteur, et plus de 52% des investissements au Maroc.
Par ces chiffres, les acteurs de l’acte de bâtir veulent non seulement rappeler l’importance économique du secteur mais aussi prévaloir celle-ci pour imposer un dialogue serein et partagé avec les instances gouvernementales et ce afin de prendre en compte l’ensemble des doléances et désarrois qui freinent leurs pratiques et qui entachent leurs réputations aux yeux de l’opinion publique.
Si, d’aventure, ces revendications de revoir les points bloquants de la loi ne se font pas, les investissements étrangers se verront contraints d’aller ailleurs, dans des pays où les règles du jeu du cadre bâti sont claires et encourageantes et non contraignantes avec en prime la privation des libertés.

La loi 66/12, les clauses du désaccord et l’incohérence du texte avec les lois et les décrets existants
Le texte de loi est en désaccord et contradiction avec la réalité du terrain et n’a pas impliqué, dans son élaboration, l’ensemble des acteurs de l’acte de bâtir dans la concertation et dans la formulation afin de comprendre la démarche du projet de l’étude, du stade esquisse à la livraison de l’ouvrage, en passant par les autorisations de construire et les plans d’exécution.
Ce texte a fait en sorte que l’ouvrage soit figé dès lors qu’il est autorisé dans sa phase de permis de construire. Il ne doit en aucun cas être transformé au cours des études approfondies ultérieures ou en cours de sa réalisation. Il faut tout prévoir à l’avance avant toute autorisation !
Une telle transformation d’adaptation technique du projet à son site ou à son programme est considérée comme infraction et elle doit être déclarée dans les 48 heures, faute de quoi des complicités seront notées et des emprisonnements se profileront en perspective en cas de récidive.
Or, le permis de construire est déposé en phase de l’avant-projet sommaire au 1/100ème pour les petits projets et au 1/200ème pour les projets conséquents avec des aléas et des incertitudes à hauteur de 15 à 20%.
A ce stade, même les études d’ingénierie, si elles existent, sont aussi sommaires car les règlements d’urbanisme en vigueur ne réglementent que les reculs, les vis-à-vis, les limites séparatives, les prospects et les gabarits ainsi que les risques contre la sécurité d’incendie.
Après obtention du permis de construire, la phase de l’avant-projet détaillé est entamée en accompagnement des bureaux d’études et des bureaux de contrôle.
Ainsi, les dimensionnements des structures en fonction des descentes de charge, des contraintes de sols, des sous-sols et des aléas séismiques ou climatiques, donneront plus de consistance au projet et assureront sa réalisation dans de bonnes conditions.
Après, avec le passage aux études d’exécution et des appels d’offres, des possibilités d’études d’optimisation et d’exécution sur le chantier sont ouvertes aux entreprises pour réaliser l’ouvrage dans de bonnes conditions.
Ainsi, des changements sont souvent opérés pendant le déroulement du chantier en fonction de la nature des sols et des exigences des laboratoires.
Avant l’achèvement du chantier, des plans de recollement sont faits suivant les indices de révision, à chaque étape de modification de la réalisation de l’ouvrage, par des géomètres topographes et une réception provisoire est lancée ainsi que des permis modificatifs reprenant tous les changements envisagés dans le déroulement du chantier.
A la réception définitive et parfois avant, la déclaration de conformité et le permis d’habiter sont déposés en conséquence.
Ce plaidoyer a pour objectif de montrer qu’à tout moment il faut stopper le projet en cas de changement et aller déposer le permis modificatif tout en attendant 3 à 6 mois pour reprendre le projet jusqu’à la prochaine modification et un nouveau dépôt de permis et ainsi de suite avec toute la pagaille des départs des entreprises et des ouvriers, l’abandon des chantiers, les conséquences financières, etc.
Ceci triplera en moyenne la durée de réalisation d’un projet et l’encombrement des agences urbaines qui n’arrivent même pas à répondre à la demande actuelle avec des lourdeurs et des temps records dénoncés par tout le monde comme frein à l’investissement dans ce pays.
L’architecte est le chef d’orchestre de l’ensemble des acteurs de la réalisation de l’ouvrage, il exerce le contrôle sur la matérialité de sa conception architecturale avec le plus grand soin.
Il vise à une exécution conforme aux plans et au cahier des charges.
Le contrôle consiste en une direction générale des travaux et toute forme de «surveillance» permanente étant exclue, ce contrôle comprend :
• la visite du chantier une fois par semaine pour les projets complexes et deux fois par mois pour les projets simples suivant le contrat signé avec le Maître d’Ouvrage,
• la conformité et l’animation des réunions des exécutants
• l’état d’avancement en donnant les indications pour la bonne exécution et les corrections ou les réfections des défauts constatés lors de la «réception provisoire».
De ce fait, ce texte de loi est en incohérence totale et en contradiction avec le déroulement des études et des réalisations des ouvrages à construire.
Il définit comme infraction tout ce qui ne correspond pas au plan autorisé, dans ce cas, toutes les études de l’avant-projet définitif à la réception provisoires, présentent des risques de privation à l’architecte de sa liberté potentielle par méconnaissance du législateur de son métier.
Par ailleurs, les arrêts de chantier prononcés par les autorités judiciaires sont aussi en contradiction avec les ordres d’arrêts et les ordres de reprises définis dans le code des marchés publics et qui sont par ailleurs réglementés et justifiés par les cas de forces majeures.